

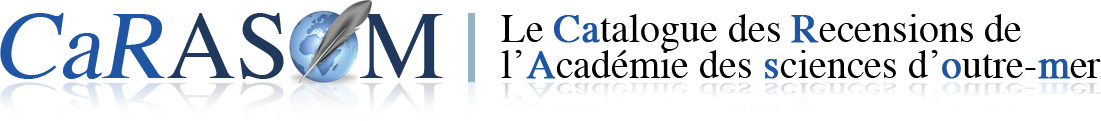
| Auteur | Christèle Dedebant |
| Editeur | Actes sud |
| Date | 2024 |
| Pages | 336 |
| Sujets | Prisonniers politiques Guyane 20e siècle Prisonniers indochinois Guyane 20e siècle Enquêtes |
| Cote | 68.530 |
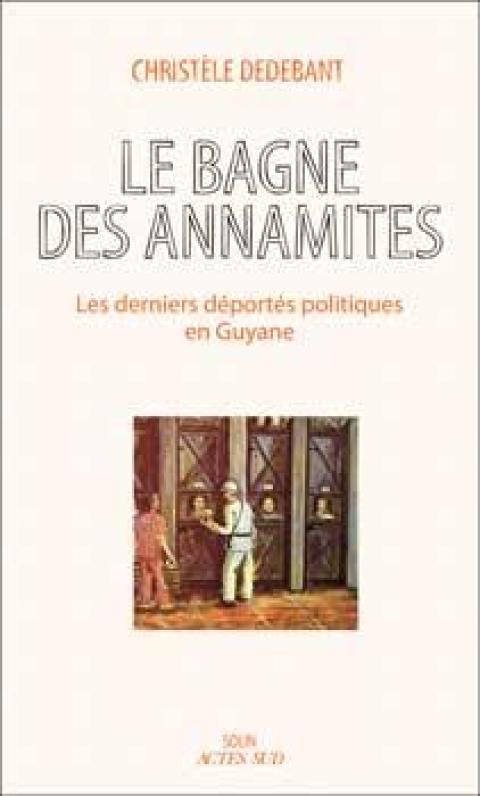
L’Indochine, avec le célèbre Poulo Condore, possédait un pénitencier destiné à recevoir les condamnés à des peines criminelles. Cela n’a pas empêché les bagnes de la Guyane, au XIXème siècle, de recevoir des Annamites, selon le vocable en usage à l’époque. Christèle Dedebant entend retracer l’histoire des derniers transportés indochinois en Guyane. Ce sont des nationalistes et des communistes qui ont accompli des attentats terroristes à Hanoï le 10 février 1930, ainsi que les mutins de la garnison de Yen Baï qui, le 28 mars, causèrent la mort de onze gradés, mais aussi des participants à une révolte de 1917 (p. 44) déjà détenus. En tout 538 hommes (p. 40).
Pourquoi ce choix de la Guyane ? Le lecteur est prié de croire l’auteur qui invoque les qualités de travail des Asiatiques auxquels on prêtait la capacité de mettre en valeur le territoire de l’Inini, c’est-à-dire l’intérieur de cette vaste colonie, qu’on avait séparé de la mince bande littorale. L’auteur lie la création du territoire de l’Inini aux émeutes qui suivirent le décès suspect de Jean Galmot, et à la volonté de se débarrasser de la présence des élus locaux (p. 30-31). Pourtant, Gober, le maire de Cayenne, était un chaud partisan du bagne (p. 35).
Toujours est-il que deux « établissements pénitentiaires spéciaux » (EPS) furent créés dont le statut était totalement différent de celui des lieux de transportation qui relevaient de l’Administration pénitentiaire. Ces EPS se situaient très légèrement en retrait de la limite séparative de l’Inini et de la Guyane proprement dite. Autrement dit, dès le départ, le choix de leur implantation laissait entrevoir que la mise en valeur de l’Inini ne serait pas au rendez-vous. Et en effet, l’expérience fut un nouvel échec du développement de cette colonie. L’implantation très excentrée en est une raison. Une autre raison est la brièveté de l’expérience. Dès le 15 septembre 1936, cinq ans après leur arrivée, 19 détenus bénéficient d’une grâce (p. 177). Les bénéficiaires de cette mesure, loin de s’être amendés, montrèrent une arrogance certaine, jusqu’à parler de leur « innocence » (p. 179). Par la suite, les décès, les évasions, la libération des détenus en fin de peine, l’absence de tout nouvel apport conduisirent à ce que l’auteur appelle la « lente agonie » des EPS, jusqu’à leur fermeture en 1949 (p. 250). Pour être complet, précisons que les Indochinois libérés boudèrent les concessions qui leur étaient offertes et préférèrent être rapatriés (p. 185, 188 et 250).
L’auteur s’intéresse particulièrement, et il faut l’en féliciter, à certaines figures des EPS. Certains se convertirent au catholicisme. L’adhésion au communisme résista rarement à l’écoulement du temps, puis au choc des réalités du régime d’Ho Chi Minh. Mais cette chronique au jour le jour de deux centres distincts, et peuplés de centaines d’individus, rend la lecture de l’ouvrage assez malaisée.
Le choix de l’auteur d’adhérer à l’idéologie dominante de son époque ne saurait lui être reproché (encore que le coup de pied de l’âne envoyé au régime de Vichy, p. 217-218, ou à Pierre Laval, p. 153, puisse arracher au lecteur un sourire de commisération), mais cela conduit parfois à de regrettables anachronismes. Ainsi, manifester son opposition au colonialisme, en relevant la « brutalité de l’État colonial » (p. 25) ou « l’extrême sévérité » des condamnations (p. 28) est-il bien pertinent, lorsque l’on sait que la mutinerie de la garnison de Yen Baï coûta la vie à onze gradés ? Affubler de guillemets le mot terroristes (p. 22), appliqué à deux poseurs de bombes, ne nous paraît pas absolument justifié. S’étonner de ce que l’envoi d’une lettre anonyme constitue une faute disciplinaire est assez dérisoire (p.191).
De même, s’insurger à tout propos contre le « racisme » de l’époque est assez pénible. Ce que l’auteur appelle racisme était un trait de la mentalité ambiante, mais cette mentalité ne procédait pas d’une idéologie et n’empêchait pas les hommes politiques de prendre en compte la réalité de la situation politique du pays, au moment de constituer des gouvernements. Ainsi est-il faux de prétendre que Monnerville et Éboué auraient été les premiers afro-descendants à accéder respectivement à un poste ministériel et à la fonction de gouverneur des colonies (p. 187). Blaise Diagne, Auguste Brunet avaient fait partie de gouvernements dans le passé, et plus tôt encore Lacascade était gouverneur à Papeete où il avait accueilli Gauguin avant d’en devenir l’ennemi.
Un personnage se voit tresser des lauriers, c’est Marius Moutet, le ministre des colonies du Front populaire. Était-il surnommé à l’époque le « député des indigènes » (p. 37, 246 et 284) ? Nous n’avons pu le vérifier. Comme député, il a pu prétendre faire bénéficier les transportés indochinois du statut de prisonniers politiques (p. 34, 37 et 45), ce qu’il refusera de faire lorsqu’il sera ministre (p. 176). La jurisprudence Gorguloff ne définit pas le crime politique en ne tenant compte que du mobile de son auteur, elle s’attache aussi au critère objectif, à la nature des actes qui ont été perpétrés. Voir dans l’attitude des autorités coloniales la volonté de punir de façon discriminatoire les détenus indochinois est une erreur.
La tête de Turc est en revanche un certain capitaine Jourdan, auquel l’auteur semble faire grief d’aimer agrémenter son cadre de vie par « de jolis parterres de fleurs aux couleurs vives », et d’avoir une bonne amie (p. 147, 172 et 173), ce qui ne nous semble pas de nature à le couvrir d’opprobre.